Les brises thermiques
Anticiper sur l'évolution du vent s'apparente pour certains à de la sorcellerie et pour d'autres à une vaste escroquerie... Pour les régatiers, il en va autrement : il est possible de déterminer les modifications du vent. C'est même nécessaire. Car anticiper, c'est gagner !
Le vent varie souvent au cours d'une journée. Il forcit, mollit, change de direction en fonction du lieu où l'on se trouve et de l'heure à laquelle on s'y trouve. Si l'on ne peut théoriser avec précision ces changements, des règles et quelques principes simples permettent souvent d'anticiper et de comprendre ce qu' Eole nous réserve pour la régate.
Les variations de vent ont trois origines principales:
- Une modification de la pression atmosphérique à grande échelle, également appelée changement du flux synoptique. C'est par exemple, une dépression qui se déplace ou un anticyclone qui se renforce.
- Le relief ou la configuration de la côte. Ce sont les effets de site.
- L'effet de brise classique, souvent appelée brise thermique, est généralement marqué par l'établissement ou le renforcement du vent de mer pendant la journée et par un affaiblissement du vent ou même d'une brise de terre la nuit.
Vent synoptique et brise
La question de l'influence du vent synoptique (celui qui est généré
par les systèmes de haute et de basse pressions) sur la brise thermique est
souvent posée.
Lorsqu'un vent synoptique est fort, l'effet de brise devient négligeable
et se fait moins ressentir, qu'il y ait ou non des cumulus.
Il n'y a d'ailleurs pas toujours addition vectorielle du vent synoptique et de la brise thermique, malgré une croyance répandue. Un vent qui souffle du large ne s'additionne pas à la brise thermique. Lors de l'Admiral's Cup 1989, c'est avec un vent synoptique de nord, donc opposé au sens de la brise thermique que la brise thermique a été la plus forte, bien qu'étant opposée au sens du vent synoptique. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. La première est qu'un vent synoptique est souvent associé à un type de masse d'air. Ainsi, dans nos régions, un vent de nord-ouest correspond généralement à une masse d'air froid, venue des hautes latitudes et donc instable et propice à l'établissement de la brise thermique.
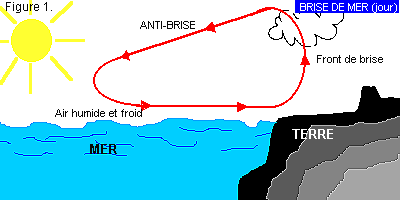
D'autre part, un vent du large gênerait l'établissement d'une brise
thermique car il s'oppose au courant de retour (ou "anti-brise") qui
opère en altitude, visible sur la figure suivante.
Si le vent du matin n'est pas complètement opposé en direction à la brise thermique, il tournera de sorte que l'angle à décrire soit minimum, d'où le nom "loi du moindre effort".
Au contraire, un vent faible de terre favorise ce courant et aide par là même à "amorcer la pompe".
Naissance de la brise
Les journées de calme sont souvent liées à une stabilité de la masse
d'air qui empêche la brise de s'établir.
Il arrive par contre qu'un léger vent de terre souffle en début de
matinée et, qu'au lieu de tomber et de se relever en brise thermique du large,
il se maintienne et se renforce en fin de matinée.
Ce phénomène est souvent visible lorsque le vent de terre souffle à
plus de force 3 le matin. Il ne tombe pas en milieu de matinée, mais, au
contraire, a tendance à se renforcer en restant du même secteur.
On constate dans ce cas, un vent synoptique établi de terre. La nuit, le
sol se refroidit et le frottement de l'air sur la terre augmente, ce qui a pour
effet de ralentir le vent. Dans la matinée, l'ensoleillement réchauffe la
masse d'air et diminue le frottement. Ce vent de terre est généralement
turbulent avec d'importantes oscillations.
Pour savoir si le vent va se renforcer de terre ou au contraire se lever
du large, il faut surveiller son évolution durant la matinée. S'il est assez
faible et mollit, il y a de fortes chances pour qu'il tombe et se relève en
brise thermique de la direction opposée. Si au contraire il se maintient, il
devrait se renforcer en restant de la même direction dès que la température
à terre montera.
Critères de stabilité
Les nuages de la famille des stratus qui couvrent tout ou une partie du
ciel de façon uniforme, sont le signe d'une stabilité de la masse d'air au
niveau du nuage.
Ces nuages sont plutôt néfastes à l'établissement d'une brise
therrnique, surtout s'ils sont bas. A l'inverse, s'ils sont assez hauts et
qu'ils se "percent" par endroit ou évoluent en cumulus plats, il est
fréquent que le mécanisme de brise s'amorce tout de même. La brume est
également un gage de stabilité et la brise thermique ne se lèvera pas tant
que la brume persistera. Les masses d'air chaud liées à la présence d'un
anticyclone sont également plutôt stables. C'est pourquoi la brise ne se lève
pas toujours pendant les plus chaudes journées de l'été.

Les stratus, surtout s'ils sont bas, nuisent à l'établissement de la brise thermique.
Une autre façon de savoir si l'air est stable ou non est d'obtenir par un service météorologique les résultats d'un radiosondage. Ces mesures, effectuées en envoyant un ballon sonde qui relève la température de l'air à différentes altitudes, permettent de voir comment évolue la température avec l'altitude et donc de savoir si la masse d'air est stable ou instable avant que d'éventuels nuages ne se soient formés.
Lors des deux dernières campagnes pour la coupe de l'America, certains défis ont également utilisé des radars qui mesurent le profil vertical de la couche d'air sur des altitudes pouvant dépassées 100 mètres.
Deux éléments sont donc nécessaires au déclenchement de la brise thermique : une différence de température entre l'air et l'eau et une instabilité de la masse d'air.
Le facteur température est généralement vérifié durant la saison
estivale au cours de l'après-midi. Il faut donc insister essentiellement sur
l'importance de l'instabilité de la masse d'air.
Au delà des causes de l'établissement de la brise thermique, il reste
à voir comment celle-ci s'établit. Rentre-t-elle par le large ou la côte en
premier ? Le vent va-t-il tomber complètement avant de rentrer à nouveau ou
bien assistera-t-on à une simple rotation du vent ? Telles sont les questions
qui reviennent le plus souvent.
Loi du moindre effort
Il semble que le vent suive ce que l'on pourrait appeler "la loi
du moindre effort". Connaissant la direction approximative de la brise
thermique, deux cas de figure peuvent se présenter le matin.
1) Le vent qui souffle en début de matinée, vient de terre et est opposé
en direction à la brise themique.
Si cette dernière s'établit, elle sera généralement précédée d'un
calme et le vent rentrera par le large. C'est un scénario que l'on observe
fréquemment. Un vent faible souffle de la côte au petit matin et il est
difficile de savoir s'il s'agit de la fin d'une brise de nuit ou d'un vent
d'origine synoptique. Il tombe complètement dans la matinée. Puis, en fin de
matinée ou en début d'après-midi, une bande de vent entre par le large; elle
tiendra tout l'après-midi. Dans le même temps, des cumulus se sont formés au
dessus de la bande côtière.
2) Le vent du matin n'est pas complètement opposé en direction à la brise
themique.
Le vent ne tombera alors pas complètement. Il tournera progressivement
jusqu'à atteindre la direction de la brise thermique classique du site. Cette
rotation, souvent associée à un renforcement du vent, s'effectuera de telle
sorte que l'angle décrit soit minimum. A La Rochelle, par exemple, si le vent
souffle du nord-est en début de matinée, il tourne vers la gauche à la
mi-journée jusqu'au nord-ouest et même, parfois à l'ouest en se renforçant.
Il n'y a généralement pas de calme dans ce cas. Le vent tourne pour se
transformer en brise thermique dans le sens où l'angle à décrire est le plus
faible, ce qui justifie que l'on appelle cette règle la loi du moindre
effort. Toujours à La Rochelle, si le vent matinal est de sud-est, la brise
rejoindra l'ouest au moindre effort, c'est-à-dire par le sud.
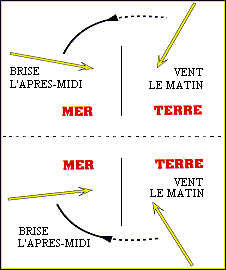
Si le vent du matin n'est pas complètement opposé en diection à la brise thermique, il tournera de sorte que l'angle à décrire soit minimum, d'où le nom "loi du moindre effort".
Une fois la brise établie, il faut savoir comment elle évolue dans la journée. On dit souvent qu'elle tourne à droite à cause de la force de Coriolis, ce qui est vrai lorsqu'il s'agit d'une brise pure. Mais la réalité met souvent en scène une combinaison de brise thermique et de vent synoptique. Il peut alors y avoir des évolutions du vent vers la gauche. Deux exemples permettront d'illustrer des rotations vers la gauche dans notre hémisphère.
On a déjà constaté qu'à La Rochelle, avec un vent de nord-est le
matin, il y a une forte probabilité pour que le vent tourne à gauche pendant
la phase d'établissement de la brise thermique. Ce n'est qu'une fois bien
établie qu'elle se stabilisera au nord-ouest ou à l'ouest et commencera
éventuellement à revenir à droite pour rejoindre le nord-est dans la soirée.
Si inversement, le vent est de sud-est le matin et s'établit au
sud-ouest sans aller j'usqu'à l'ouest l'après-midi, il y a de fortes chances
pour qu'il revienne à gauche en fin d'après midi ou en début de soirée, vers
sa direction initiale.
Enfin, il arrive que la brise thermique s'établisse selon une certaine
direction et qu'elle n'en change guère pendant plusieurs heures. La rotation
vers la droite de la brise thermique n'est donc pas toujours vérifiée.
Si la brise s'est établie sans que le vent ne tombe complètement (loi
du moindre effort), il y a des chances pour que le vent revienne à son
secteur d'origine lorsque la brise tombera. On peut admettre que si le vent
n'atteint pas, à l'heure où la brise est établie, sa direction habituelle, il
repart en fin de journée du côté où il est venu. Cela veut dire qu'il y a
une composante synoptique dans le thermique (figure 2).
Dans le cas d'un thermique pur, le vent effectue bien une rotation
continue vers la droite avec tout de même quelques oscillations. Cette rotation
s'effectue sur 360°. Elle peut être ponctuée par deux calmes, l'un dans la
matinée et l'autre pendant la nuit.